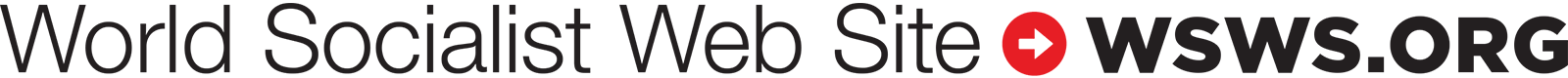«Le Projet 1619», publié par le New York Times en édition spéciale de 100 pages dans son magazine du 19 août, présente et interprète l’histoire américaine entièrement du point de vue de la race et des conflits raciaux. Le « Projet » a été publié à l’occasion du 400e anniversaire de la première arrivée d’esclaves africains à Port Comfort en Virginie, une colonie britannique d’Amérique du Nord; les vingt esclaves furent échangés le lendemain contre de la nourriture.
Selon le Times, le projet vise à «recadrer l’histoire du pays, à comprendre 1619 comme notre véritable fondation. Autrement dit, placer les conséquences de l’esclavage et les contributions des noirs américains au centre même du récit de notre identité».
Malgré sa prétention à construire la «véritable» fondation des États-Unis, le Projet 1619 est en fait une falsification de l’histoire à motivation politique. Son but est de créer un récit historique qui légitime les efforts déployés par le Parti démocrate pour monter une coalition électorale basée sur la primauté de l’«identité» personnelle, c’est à dire le genre, la préférence sexuelle, l’ethnicité et, surtout, la race.
Le Times a fait la réclame de ce projet grâce à un ‘blitz’ publicitaire sans précédent, abondamment financé. Il y collabore avec le Pulitzer Center on Crisis Reporting, un organisme de presse ayant élaboré un projet de cursus scolaire qui sera envoyé aux écoles en vue de le faire utiliser en classe par les enseignants. On a imprimé et distribué gratuitement dans les écoles, les bibliothèques et les musées du pays des centaines de milliers d’exemplaires du magazine ainsi qu’un supplément spécial. On enverra Nikole Hannah-Jones, écrivaine et membre de la New America Foundation, qui a lancé l’idée du projet, en a supervisé la production et rédigé l’introduction, faire une tournée nationale de conférences dans les écoles.
Les essais présentés dans le magazine tournent tous autour de la prémisse que toute l’histoire américaine est ancrée dans la haine raciale, en particulier la haine incontrôlable des «noirs» par les «blancs». Hannah-Jones écrit dans l’introduction de la série d’essais: «Le racisme anti-noir se trouve dans l’ADN même de ce pays.»
C’est là une conception fausse et dangereuse. L’ADN est une molécule chimique qui contient le code génétique des organismes vivants et détermine leurs caractéristiques physiques et leur développement. Le transfert de ce terme biologique clé à l’étude d’un pays – ne serait-ce que dans un sens métaphorique – conduit à de la mauvaise histoire et à une politique réactionnaire. Les pays n’ont pas d’ADN, ils ont des structures économiques formées au cours de l’histoire, des classes antagonistes et des relations politiques complexes. Celles-ci n’existent pas en dehors d’un certain niveau de développement technologique ni indépendamment d’un réseau plus ou moins développé d’interrelations économiques au plan mondial.
La méthodologie qui sous-tend le Projet 1619 est idéaliste (c’est-à-dire qu’elle tire l’être social de la pensée plutôt que l’inverse) et, au sens le plus fondamental du terme, irrationnelle. Toute l’histoire s’expliquerait par l’existence d’une impulsion émotionnelle supra-historique. L’esclavage n’est pas considéré ni analysé comme une forme spécifique de l’exploitation du travail ayant sa base dans l’économie, mais plutôt comme la manifestation du racisme blanc. Mais d’où vient ce racisme? Selon Hannah-Jones, il fait partie de l’ADN historique des Américains «blancs». Il doit donc persister indépendamment de tout changement des conditions politiques ou économiques.
La référence d’Hannah-Jones à l’ADN fait partie d’une tendance croissante à dire que les antagonismes raciaux viennent de processus biologiques innés. Dans un essai publié récemment dans le magazine Foreign Affairs, Stacey Abrams, femme politique du Parti démocrate, affirme qu’une «différence intrinsèque» sépare blancs et afro-américains.
Cette assertion irrationnelle et scientifiquement absurde sert à légitimer la vision réactionnaire – entièrement compatible avec la perspective politique du fascisme – selon laquelle les noirs et les blancs sont des espèces hostiles et incompatibles.
Dans un autre article publié dans Foreign Affairs, le neurologue Robert Sapolsky affirme que l’antagonisme entre les groupes humains a des origines biologiques. Extrapolant à partir des conflits territoriaux sanglants entre chimpanzés dont «l’ADN est partagé à plus de 98 pour cent» par les humains, Sapolsky affirme que pour comprendre «la dynamique de l’identité des groupes humains, y compris la résurgence du nationalisme – la forme potentiellement la plus destructrice des préjugés intergroupes – il faut comprendre les bases biologiques et cognitives qui lui donnent sa forme».
La dilution simpliste de l’Histoire par Sapolsky dans la biologie rappelle non seulement l’invocation réactionnaire du «darwinisme social» pour légitimer la conquête impérialiste à la fin du XIXe siècle et au début du XXe mais aussi les efforts de généticiens allemands pour fournir une justification pseudo-scientifique à l’antisémitisme et au racisme nazi.
Des idées dangereuses et réactionnaires surgissent dans les milieux académiques et politiques bourgeois. Nul doute que les auteurs des essais du Projet 1619 nieraient qu’ils prédisent la guerre des races, et encore moins qu’ils justifient le fascisme. Mais les idées ont une logique; et les auteurs sont responsables des conclusions politiques et des conséquences de leurs arguments faux et erronés.
L’esclavage américain est un sujet monumental d’une importance historique et politique vaste et durable. Les événements de 1619 font partie de cette histoire. Mais ce qui s’est passé à Port Comfort est un épisode de l’histoire mondiale de l’esclavage, qui remonte au monde antique, et des origines et du développement du système capitaliste mondial. Une littérature abondante existe qui traite de la pratique répandue de l’esclavage hors des Amériques. Comme l’explique le professeur G. Ogo Nwokeji, du Département d’études afro-américaines de l’Université de Californie, l’esclavage fut pratiqué par les sociétés africaines. Il existait en Afrique de l’Ouest «bien avant le XVe siècle, lorsque les Européens y sont arrivés par l’océan Atlantique» [1].
L’historien Rudolph T. Ware III, de l’Université du Michigan, écrit: «Entre le début du XVe siècle et la fin du XVIIIe siècle, des millions de personnes ont vécu et sont mortes en esclavage dans les sociétés musulmanes d’Afrique» [2]. Parmi les ouvrages scientifiques contemporains les plus importants sur ce sujet, citons «Transformations de l’esclavage: l’Histoire de l’esclavage en Afrique», publié en 1983 par l’historien canadien Paul E. Lovejoy, qui explique:
L’esclavage a été un phénomène important et répandu en de nombreuses régions du monde tout au long de l’histoire, de l’antiquité classique jusqu’à une époque très récente. L’Afrique est intimement liée à l’histoire de l’esclavage, d’abord parce que le continent a été un vivier majeur d’esclaves pour les anciennes civilisations, le monde islamique, l’Inde et les Amériques mais également car c’est l’une des zones géographiques dans lesquelles l’esclavage s’est développé de la manière la plus importante. De fait, en Afrique, l’esclavage a perduré jusqu’au XXe siècle, soit bien plus longtemps que dans les Amériques. Il convient d’explorer les ressorts d’une telle ancienneté et la persistance de cette pratique, à la fois pour comprendre le développement historique de l’esclavage sur le continent africain, mais également pour comprendre le rôle qu’a pu jouer la traite des esclaves dans cette histoire. Pour brosser cette évolution à grands traits: la pratique de l’esclavage sur le continent s’est développée à la faveur de trois grandes étapes, au moins, de 1350 à 1600, de 1600 à 1800 et de 1800 à 1900, lorsque l’esclavage est devenu une dimension fondamentale de l’économie politique africaine. [3]
Dans la préface de la troisième édition de son étude désormais classique, le professeur Lovejoy fait remarquer que l’objectif initial, en entreprenant ses recherches, «était de confronter la réalité de l’esclavage en Afrique à une époque où des visionnaires romantiques et nationalistes optimistes voulaient nier des faits qui sont pourtant clairs». [4]
Par rapport au Nouveau Monde, le phénomène de l’esclavage dans l’histoire moderne ne peut être compris indépendamment de son rôle dans le développement économique du capitalisme aux XVIe et XVIIe siècles. Comme l’explique Karl Marx dans le chapitre intitulé «La genèse du capitaliste industriel» dans le premier volume du Capital:
La découverte des contrées aurifères et argentifères de l’Amérique, la réduction des indigènes en esclavage, leur enfouissement dans les mines ou leur extermination, les commencements de conquête et de pillage aux Indes orientales, la transformation de l’Afrique en une sorte de garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà les procédés idylliques d’accumulation primitive qui signalent l’ère capitaliste à son aurore. Aussitôt après, éclate la guerre mercantile; elle a le globe entier pour théâtre. S’ouvrant par la révolte de la Hollande contre l’Espagne, elle prend des proportions gigantesques dans la croisade de l’Angleterre contre la Révolution française et se prolonge, jusqu’à nos jours, en expéditions de pirates, comme les fameuses guerres d’opium contre la Chine. [5]
L’analyse de Marx a inspiré la pensée critique du brillant historien antillais, Eric Williams qui a écrit dans son étude novatrice, Capitalisme et Esclavage, publiée en 1944:
Le terme d’esclavage dans les Caraïbes a été trop exclusivement appliqué aux Nègres. Une déformation raciste a été donnée à ce qui était fondamentalement un phénomène économique. L’esclavage n’est pas né du racisme. Le racisme a été plutôt la conséquence de l’esclavage. La main-d’œuvre forcée dans le Nouveau Monde était brune, blonde, noire ou jaune ; catholique, protestante ou païenne. [6]
On ne peut comprendre la formation et le développement des États-Unis hors des processus économiques et politiques internationaux ayant donné naissance au capitalisme et au Nouveau Monde. L’esclavage était une institution économique internationale qui s’étendait depuis le cœur de l’Afrique jusqu’aux chantiers navals de Grande-Bretagne, aux banques d’Amsterdam et aux plantations de Caroline du Sud, du Brésil et des Caraïbes. Toutes les puissances coloniales y prenaient part, des Hollandais exploitant des postes de traite d’esclaves en Afrique occidentale, aux Portugais qui importaient des millions d’esclaves au Brésil. On estime que 15 à 20 millions d’Africains furent envoyés de force dans les Amériques sur toute la période de la traite transatlantique. De ce nombre, 400.000 se sont retrouvés dans les 13 colonies britanniques, c’est-à-dire aux États-Unis.
L’esclavage était l’héritage inéluctable et politiquement tragique des fondations mondiales des États-Unis. Il n’est pas difficile de reconnaître la contradiction entre les idéaux proclamés par les dirigeants de la Révolution américaine, exprimés avec une force prodigieuse par Thomas Jefferson dans la Déclaration d’indépendance, et l’existence de l’esclavage dans des États-Unis nouvellement formés.
Mais l’Histoire n’est pas un conte moral. Les efforts visant à discréditer la Révolution en se concentrant sur la prétendue hypocrisie de Jefferson et d’autres fondateurs ne contribuent en rien à sa compréhension. La Révolution américaine ne peut être comprise comme la somme des intentions subjectives et des limites morales de ceux qui l’ont dirigée. La signification historique de la Révolution dans le monde ne peut vraiment être comprise qu’à travers un examen de ses causes et conséquences objectives.
L’analyse fournie par Williams réfute la tentative calomnieuse du Projet 1619 de dépeindre la Révolution américaine comme un effort sinistre visant à maintenir le système esclavagiste. Outre l’impact politique massif de la Déclaration de Jefferson et le renversement subséquent de la domination britannique, Williams soulignait l’impact objectif de la Révolution sur la viabilité économique de l’esclavage. Il écrit:
«Dans le cours des événements, lorsqu’il s’avère nécessaire pour un peuple de rompre les liens politiques qui le rattachent à un autre…» Jefferson n’écrivait là qu’une moitié de la vérité. C’étaient les liens économiques, et non politiques, qu’on était en train de trancher. Une nouvelle ère s’ouvrait. L’année 1776 fut marquée par la Déclaration de l’Indépendance et la publication de la «Richesse des nations». Loin d’ajouter à la valeur des îles de la canne à sucre, l’indépendance américaine fut le signal de leur déclin, un déclin qui ne devait plus s’arrêter. Comme on le disait communément, à l’époque, la Grande-Bretagne n’avait pas seulement perdu treize colonies, mais en plus, huit îles. [7]
Que le célèbre appel de l’abolitionniste anglais William Wilberforce à mettre fin à la traite négrière britannique soit venu seulement quatre ans après la fin victorieuse de la guerre révolutionnaire de 1783 n’était pas le fait du hasard.
Dans son examen de l’émergence de l’opposition britannique à la traite négrière Williams soulève un point fondamental sur l’étude de l’histoire qui est en soi une condamnation de la méthode subjective et anhistorique employée par le Projet 1619. Il écrit:
Capitalisme et Esclavage, Eric Williams, Présence Africaine, Paris, p. 270
Les forces dont l’influence était décisive pendant la période d’histoire que nous avons examinée sont les forces économiques en évolution. Les changements économiques sont graduels, imperceptibles, mais ils ont un effet cumulatif irréversible. Les hommes, dans la poursuite de leurs intérêts, sont rarement conscients des buts ultimes vers lesquels tendent leurs activités. Le capitalisme commercial du XVIIIe siècle a développé la richesse de l’Europe par l’esclavage et le monopole. Mais ce faisant, il a contribué à la création du capitalisme industriel du XIXe siècle, dont l’évolution nouvelle a entraîné la destruction de la puissance du capitalisme mercantile, de l’esclavage et de ses œuvres. Si l’on n’a pas compris ces changements économiques, l’histoire de cette période reste dénuée de sens. [8]
La victoire de la Révolution américaine et la création des États-Unis n’ont pas résolu le problème de l’esclavage. Les conditions économiques et politiques de son abolition n’avaient pas suffisamment mûri. Mais le développement économique des États-Unis – le développement simultané de l’industrie dans le Nord et la croissance nocive du système des plantations de coton dans le Sud (suite à l’invention de l’égreneuse de coton en 1793) – a intensifié les contradictions entre deux systèmes économiques de plus en plus incompatibles, l’un basé sur le travail salarié et l’autre sur l’esclavage.
Durant les sept décennies qui séparent l’adoption de la Constitution et l’élection de George Washington comme président (1789) de l’investiture d’Abraham Lincoln et du déclenchement de la Guerre de sécession (1861), les États-Unis sont allés de crise en crise. Aucun des compromis répétés visant à créer un équilibre entre États esclavagistes et États libres, depuis le Compromis du Missouri en 1820 jusqu’à la Loi de Kansas-Nebraska en 1854, n’a jamais réussi à régler définitivement la question.
Il faut garder à l’esprit que les 87 ans d’histoire invoqués par Lincoln lors de son discours de Gettysburg en 1863 représentaient la même période de temps que celle qui sépare notre époque de l’élection de Franklin Delano Roosevelt en 1932. C’est au cours de cette période relativement comprimée que les tendances socio-économiques explosives qui allaient faire disparaître tout le système économique de l’esclavage se sont développées et ont éclaté.
La fondation des États-Unis a déclenché une crise qui a débouché sur la guerre de Sécession – la deuxième Révolution américaine. Au cours de cette guerre, des centaines de milliers de blancs ont donné leur vie pour mettre enfin un terme à l’esclavage. Il faut souligner qu’il ne s’agit pas là d’un résultat accidentel, et encore moins inconscient, de la Guerre civile. Cette guerre a abouti finalement à la plus grande expropriation de propriété privée de l’histoire mondiale, sans égale jusqu’à la Révolution russe de 1917 où la classe ouvrière, dirigée par le Parti bolchevique, a pris le pouvoir pour la première et jusqu’à présent seule fois de l’histoire mondiale.
Hannah-Jones ne considère pas Lincoln comme «le Grand émancipateur», nom que lui donnaient les esclaves affranchis dans les années 1860, mais comme un raciste ordinaire qui voyait dans «le peuple noir l’obstacle à l’unité nationale». Elle ne tient aucun compte des propres paroles prononcées par Lincoln, dans son discours de Gettysburg ou dans sa magistrale Deuxième allocution inaugurale par exemple ; ni des livres écrits par des historiens comme Eric Foner, James McPherson, Allen Guelzo, David Donald, Ronald C. White, Stephen Oates, Richard Carwardine et bien d’autres, qui montrent comment Lincoln s’est affirmé comme un chef révolutionnaire pleinement déterminé à en finir avec l’esclavage.
Mais un portrait honnête de Lincoln contredirait l’affirmation d’Hannah-Jones selon laquelle «les noirs américains se sont battus seuls» pour «faire de l’Amérique une démocratie». C’est aussi pourquoi on ne trouve, nulle part dans le magazine, la moindre mention des 2,2 millions de soldats de l’Union ayant combattu ni des 365.000 morts pour en finir avec l’esclavage.
On cache de même le caractère interracial du mouvement abolitionniste. Les noms de William Lloyd Garrison, Wendell Phillips, Elijah Lovejoy, John Brown, Thaddeus Stevens et Harriet Beecher Stowe, entre autres, sont absents de son essai. Quelques abolitionnistes sont cités de manière sélective pour leur critique de la Constitution, mais Hannah-Jones n’ose pas mentionner que, pour le mouvement anti-esclavagiste, la Déclaration d’indépendance de Jefferson était, selon les mots de feu l’historien David Brion Davis, leur «pierre de touche, la sainte Écriture».
Hannah-Jones et les autres collaborateurs du projet 1619 – qui prétendent que l’esclavage était le «péché originel» unique des États-Unis et tentent de discréditer la Révolution américaine et la Guerre de sécession comme des conspirations sophistiquées pour perpétuer le racisme blanc, ont peu de choses à dire sur le reste de l’histoire américaine. Rien n’a jamais changé. La ségrégation ‘Jim Crow’ a simplement remplacé l’esclavage, et fut remplacée à son tour par la condition raciste permanente qui est le destin inéluctable de l’«Américain blanc ». Tout cela remonte à 1619 et à «la racine du racisme endémique dont nous ne pouvons toujours pas purger cette nation à ce jour». [9] [souligné par nous]
Il ne s’agit pas simplement là d’un «recadrage» de l’histoire mais d’une attaque et d’une falsification qui ignorent plus d’un demi-siècle de recherche. Il n’y a pas la moindre indication que Hannah-Jones (ou l’un de ses co-essayistes) connaisse seulement, sans parler de les avoir lu, les travaux sur l’esclavage réalisés par Williams, Davis ou Peter Kolchin; ou ceux sur la Révolution américaine de Bernard Bailyn et Gordon Wood; ou ceux sur les conceptions politiques motivant les soldats de l’Union par James McPherson; sur la reconstruction par Eric Foner; sur la ségrégation Jim Crow par C. Vann Woodward; et la Grande Migration, par James N. Gregory ou Joe William Trotter.
Combien est passé à la trappe dans la fable de moralité racialiste du New York Times, même du point de vue de la recherche afro-américaine, est à couper le souffle. L’invocation du racisme blanc remplace tout examen concret de l’histoire économique, politique et sociale du pays.
Il n’y a aucun examen du contexte historique, avant tout de l’évolution de la lutte de classe dans le cadre de laquelle s’est développée la lutte de la population afro-américaine au cours du siècle qui a suivi la guerre civile. Et il n’y a aucune référence à la transformation des États-Unis en colosse industriel et plus puissant pays impérialiste entre 1865 et 1917, l’année de son entrée dans la Première Guerre mondiale.
Si le Projet 1619 et son écurie d’auteurs nantis voient dans l’exploitation esclavagiste du travail un talisman pour expliquer toute l’Histoire, leur silence sur l’exploitation inhérente au travail salarié est assourdissant.
Qui lit leur Projet 1619 ne saurait pas que la lutte contre l’esclavage a débouché sur une lutte violente contre l’esclavage salarié, dans laquelle se sont fait tuer d’innombrables travailleurs. Nulle part on ne trouve de référence à la grande grève des chemins de fer de 1877 qui s’est propagée comme une traînée de poudre le long des voies ferrées de Baltimore jusqu’à Saint Louis, et que seul le déploiement de troupes fédérales a pu réprimer. Pas de référence non plus à l’émergence des Chevaliers du Travail; à la lutte pour la journée de huit heures; au massacre de Haymarket; à la grande grève de l’acier de Homestead en 1892; à la grève de Pullman de 1894; à la formation de la centrale syndicale AFL; à la fondation du Parti socialiste; à l’émergence de l’IWW; au massacre de Ludlow; à la grande grève de l’acier de 1919; aux innombrables autres luttes ouvrières qui ont suivi la Première Guerre mondiale, et enfin à l’émergence de la centrale syndicale CIO et aux luttes industrielles massives des années 30.
Bref, il n’y a pas de lutte de classe. Par conséquent, il n’y a pas de réelle histoire de la population afro-américaine ni des événements qui ont fait d’une population d’esclaves libérés une partie cruciale de la classe ouvrière. Remplaçant l’histoire réelle par un récit racial mythique, le Projet 1619 ignore le développement social réel de la population afro-américaine au cours des 150 dernières années.
Nulle part les auteurs ne discutent de la Grande Migration qui, entre 1916 et 1970, a vu des millions de noirs et de blancs, arrachés au sud rural, affluer dans les zones urbaines des États-Unis pour y travailler, en particulier dans le nord industrialisé. James P. Cannon, le fondateur du trotskysme américain, a saisi dans son inimitable prose les implications révolutionnaires de ce processus, tant pour les Afro-Américains que pour les travailleurs blancs:
Le capitalisme américain a pris des centaines de milliers de nègres dans le Sud et, exploitant leur ignorance, leur pauvreté, leurs craintes et leur impuissance individuelle, les a attroupés dans les aciéries comme briseurs de grève durant la grève de l’acier de 1919. Et en l'espace d'une courte génération, par les mauvais traitements, les abus et l'exploitation de ces nègres innocents et ignorants briseurs de grève, ce même capitalisme a réussi à les transformer, eux et leurs fils, en un des détachements les plus combatifs et les plus fiables de la grande grève de l'acier victorieuse de 1946.
Ce même capitalisme a pris des dizaines et des centaines de milliers de péquenauds à préjugés du Sud, dont beaucoup étaient membres et sympathisants du Ku Klux Klan, et pensant les utiliser, avec leur ignorance et leurs préjugés, comme une barrière contre le syndicalisme, les a aspirés dans les usines de voitures et de caoutchouc de Detroit, Akron et d’autres centres industriels. Là, il les a fait suer, les a humiliés, forcés à travailler et exploités jusqu'à ce qu'il finisse par les changer et en faire des hommes nouveaux. A cette dure école, les sudistes importés apprirent à échanger les insignes du KKK contre l’insigne syndical du CIO, et à transformer la croix de feu du Klansman en brasier pour réchauffer les piquets de grève aux portes des usines. [10]
Jusqu’en 1910, près de 90 pour cent des Afro-Américains vivaient dans les anciens États esclavagistes, pour la grande majorité dans des conditions d’isolement rural. Dans les années 1970, ils étaient fortement urbanisés et prolétarisés. Les travailleurs noirs avaient vécu les grandes grèves industrielles, aux côtés des blancs, dans des villes telles que Detroit, Pittsburgh et Chicago. Ce n’est pas un hasard historique si le mouvement des droits civiques est apparu dans le Sud à Birmingham, en Alabama, centre de l’industrie sidérurgique et foyer d’action de travailleurs communistes, noirs et blancs.
La lutte du travail salarié contre le capital au moment de la production unissait les travailleurs au-delà des frontières raciales. Ainsi, dans sa rhétorique enfiévrée, l’homme politique ségrégationniste assimilait le mouvement des Droits civiques au communisme et à la peur du «métissage racial» – c’est-à-dire à la peur que les masses ouvrières, noires et blanches, ne s’unissent autour de leurs intérêts communs.
Tout comme il ignore l’histoire de la classe ouvrière, le Projet 1619 ne donne pas d’histoire politique. On ne rend pas compte du rôle du Parti démocrate, une alliance entre industriels et politiciens intéressés dans le Nord et le régime esclavagiste puis les politiciens de type «Jim Crow» dans le Sud, qui visait à dresser délibérément travailleurs blancs et noirs les uns contre les autres en fomentant la haine raciale.
Dans les nombreux articles qui composent le Projet 1619, le nom de Martin Luther King n’apparaît qu’une seule fois et cela seulement dans la légende d’une photo. La raison en est que les perspectives politiques de King s’opposaient au discours raciste avancé par le Times. King ne condamne pas la Révolution américaine ni la Guerre de Sécession. Il ne croyait pas que le racisme était une caractéristique permanente de la «blancheur». Il appelait à l’intégration des noirs et des blancs et se donnait pour but la dissolution ultime de la race même. King était visé et harcelé par le FBI en tant que «communiste». On l’a assassiné après qu’il ait lancé la campagne interraciale des pauvres et annoncé son opposition à la guerre du Vietnam.
King encourageait l’engagement de militants blancs des droits civiques, dont plusieurs ont perdu la vie dans le Sud, dont Viola Liuzzo, l’épouse d’un organisateur syndical des ‘Teamsters’ de Detroit. La déclaration de King suite à l’assassinat de trois jeunes militants des droits civiques en 1964, Michael Schwerner, James Chaney et Andrew Goodman (dont deux étaient blancs), était une condamnation passionnée du racisme et de la ségrégation. De toute évidence, King ne s’accorde pas avec le récit d’Hannah-Jones.
Mais l’omission la plus importante et la plus révélatrice du Projet 1619 est qu’il ne parle pas du tout de l’événement qui a eu l’impact le plus important sur la condition sociale des Afro-Américains :la Révolution russe de 1917. Celle-ci a non seulement éveillé et inspiré de larges couches de la population afro-américaine – dont d’innombrables intellectuels, écrivains et artistes noirs comme W.E.B. Du Bois, Claude McKay, Langston Hughes, Ralph Ellison, Richard Wright, Paul Robeson et Lorraine Hansberry – elle a encore sapé les fondations politiques de l’apartheid racial américain.
Étant donné le récit nationaliste noir du Projet 1619, il peut sembler surprenant que n’apparaissent nulle part les noms de Malcolm X ou des Black Panthers. Contrairement aux nationalistes noirs des années 1960, Hannah-Jones ne condamne pas l’impérialisme américain. Elle se vante de ce que c’est «nous » [c’est-à-dire les Afro-Américains] qui « sommes le groupe racial le plus susceptible de servir dans l’armée des États-Unis». Elle célèbre le fait que «nous» avons combattu «dans chaque guerre que cette nation a menée». Hannah-Jones n’évoque pas ce fait de manière critique. Elle ne condamne pas la création d’une armée «volontaire» dont les recruteurs s’attaquent aux jeunes des minorités pauvres. Rien n’indique qu’Hannah-Jones s’oppose à la «guerre contre le terrorisme», ni aux interventions brutales en Irak, en Libye, au Yémen, en Somalie et en Syrie – toutes soutenues par le Times – qui ont tué ou déplacé plus de 20 millions de personnes. Sur ce point, Hannah-Jones est remarquablement «daltonienne». Elle méconnaît les millions de «personnes de couleur» massacrées et réfugiées par la machine de guerre américaine au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique, ou y est tout simplement indifférente.
La politique identitaire toxique qui sous-tend cette indifférence ne sert pas les intérêts de la classe ouvrière, aux États-Unis ou ailleurs, qui dépend pour sa survie même de son unification au-delà des frontières raciales et nationales. Elle sert en revanche les intérêts de classe des couches privilégiées de la classe moyenne supérieure américaine.
Dans un passage révélateur à la fin de son essai, Hannah-Jones déclare que depuis les années 1960, «les noirs américains ont fait des progrès étonnants, non seulement pour nous, mais aussi pour tous les Américains». Elle ne parle pas ici au nom de sa «race», mais au nom d’une toute petite couche de l’élite afro-américaine, bénéficiaire de la politique d’«action affirmative» qui est arrivée la maturité politique dans les années conduisant à l’Administration de Barack Obama, le premier président noir des États-Unis.
Une analyse des données économiques faite en 2017 a révélé des taux extrêmes d’inégalité de richesse au sein des groupes raciaux. Parmi ceux se déclarant Afro-Américains, les 10 pour cent les plus riches contrôlaient 75 pour cent de toute la richesse; pendant le mandat d’Obama, le un pour cent le plus riche a augmenté sa part de la richesse de tous les Afro-Américains de 19,4 pour cent à 40,5 pour cent. Par ailleurs, on estime que la moitié inférieure des ménages afro-américains ont une richesse nulle ou négative.
Si on a délibérément cultivé une couche très mince de millionnaires et de milliardaires noirs en réponse aux troubles de masse des années 1960 et 1970, les conditions de vie de la classe ouvrière afro-américaine elles, sont pires qu’il y a 40 ans. Cette période est celle de la désindustrialisation qui a vu la fermeture systématique des usines sidérurgiques, automobiles et autres aux États-Unis et a dévasté des villes ouvrières comme Detroit, Milwaukee et Youngstown en Ohio.
Les avancées sociales majeures obtenues par les travailleurs dans les luttes acharnées du XXe siècle ont été réduites à néant pour pouvoir transférer une immense quantité de richesse des 90 pour cent inférieurs de la population vers le sommet. La pauvreté, la baisse de l’espérance de vie, les morts de désespoir et d’autres formes de misère sociale rapprochent les travailleurs de toutes origines raciales et nationales.
Ce n’est pas un hasard si le Times – le porte-parole du Parti démocrate et des couches privilégiées de la haute classe moyenne qu’il représente – fait la promotion de ce récit racial de l’histoire américaine au moment de la montée de la lutte des classes aux États-Unis et dans le monde.
Cette année, les travailleurs de Matamoros, au Mexique, ont demandé à leurs homologues américains de l’automobile, blancs et noirs, de rejoindre leurs grèves sauvages. Partout dans le Sud, des travailleurs noirs, blancs et hispaniques ont fait grève ensemble contre le géant des télécommunications AT&T. Au Tennessee, des voisins noirs et blancs ont défendu une famille ouvrière immigrée contre la déportation. Aujourd’hui, la main-d’œuvre automobile américaine multiraciale et multiethnique entre dans une bataille féroce contre les géants mondiaux de l’automobile et les syndicats corrompus.
En même temps, les sondages montrent que la population soutient de plus en plus le socialisme – c’est à dire l’unité politique consciente de la classe ouvrière à travers toutes les frontières et les divisions qui lui sont imposées. Dans ces conditions, l’élite capitaliste américaine, démocrate comme républicaine, est terrifiée par la révolution sociale. Elle se joint à ses homologues de la classe dirigeante du monde entier pour utiliser une politique sectaire, fondée sur la race, la religion, la nationalité, l’ethnicité ou la langue pour bloquer ce développement.
Le Projet 1619 est l’une des composantes d’un effort délibéré visant à placer la politique raciale au cœur de l’élection de 2020 et à fomenter les divisions dans la classe ouvrière. Les Démocrates pensent que, pour le moment, ils gagneraient à ne plus se concentrer sur la campagne réactionnaire et militariste anti-Russie mais sur une politique raciale tout aussi réactionnaire.
Le rédacteur en chef du Times, Dean Baquet, a été explicite à cet égard. Il a déclaré au personnel, lors d’une réunion en août, que le récit sur lequel se concentrerait le journal ne serait plus: «un récit de la campagne Trump en collusion avec la Russie ni son obstruction à la justice, mais une histoire plus directe sur le caractère du président». En conséquence, la rédaction enjoindrait les journalistes à «écrire plus en profondeur sur le pays, la race et les autres divisions».
Baquet a déclaré:
La race et la compréhension de la race devraient faire partie de la façon dont nous parlons de l’histoire américaine… Une raison pour laquelle nous avons tous approuvé le Projet 1619 et l’avons rendu si ambitieux et étendu était d’apprendre à nos lecteurs à penser un peu plus comme cela. L’année prochaine, la race – et j’espère que c’est, pour être franc, ce que vous allez retenir de cette discussion – va jouer un rôle énorme dans le récit américain.
Cette concentration sur la race est une image réfléchie de la politique raciale de Trump et elle ressemble de façon troublante à la vision du monde fondée sur la race des nazis. L’analyse par Trotsky de l’idéologie du fascisme allemand explique de manière concise le rôle central de la race dans la politique du fascisme:
Pour élever la nation au-dessus de l’histoire, on lui donne le soutien de la race. L’histoire est vue comme une émanation de la race. Les qualités de la race sont construites indépendamment des conditions sociales changeantes. Rejetant «la pensée économique» comme vile, le national-socialisme descend un étage plus bas: du matérialisme économique il passe au matérialisme zoologique. [11]
Beaucoup de chercheurs, d’étudiants et d’ouvriers savent que le Projet 1619 est une parodie de l’histoire. C’est leur responsabilité de prendre position et de rejeter la tentative coordonnée, dirigée par le Times, de déterrer et de réhabiliter une falsification réactionnaire fondée sur la race de l’histoire américaine et mondiale.
La classe ouvrière doit par-dessus tout rejeter tous les efforts de ce genre pour la diviser. De tels efforts deviendront de plus en plus féroces et pernicieux à mesure que la lutte de classe se développera. Le grand enjeu de cette époque est la lutte pour l’unité internationale de la classe ouvrière contre toutes les formes de racisme, de nationalisme et de politique identitaire du même acabit.
Dans les semaines et mois à venir, le World Socialist Web Site fera connaître et rapportera les conférences que va organiser l’«International Youth and Students for Social Equality» (IYSSE) où sera démasquée la politique réactionnaire anti-ouvrière et les falsifications historiques promues par le Projet 1619.
Notes:
[1] The Cambridge World History of Slavery, Volume 3, AD1420-AD1804, édité par David Eltis et Stanley L. Engerman,[Cambridge: 2011], p. 81 (Traduit de l’anglais)
[2] Ibid., p. 47. (Traduit de l’anglais:)
[3] Paul E. Lovejoy, Une histoire de l’esclavage en Afrique : Mutations et Transformations (XIVe – XXe siècle) (Éditions Karthala et CIRESC, Paris: 2017), p. 23
[4] Ibid., p. 19
[5] Karl Marx, Capital Tome 1 https://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-31.htm
[6] Capitalisme et Esclavage, Eric Williams, Présence Africaine, Paris, p. 19
[7] Capitalisme et Esclavage, Eric Williams, Présence Africaine, Paris, p. 158
[8] Capitalisme et Esclavage, Eric Williams, Présence Africaine, Paris, p. 270
[9] The New York Times Magazine, 18 août 2019, p. 19. (Traduit de l’anglais:)
[10] James P. Cannon, "The Coming American Revolution", discours prononcé lors de la douzième Convention nationale du Parti socialiste ouvrier, 1946. (Traduit de l’anglais)
[11] Leon Trotsky, «Qu’est-ce que le national-socialisme?» disponible sur https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1933/06/330610.htm
(Article paru d’abord en anglais le 3 septembre 2019)